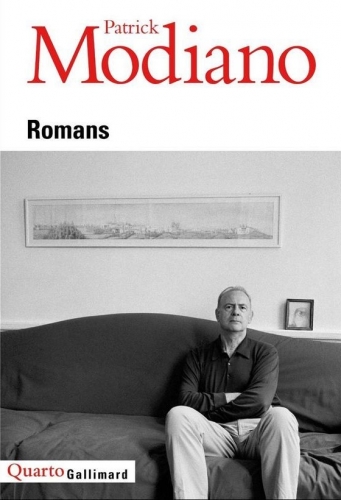Paru en 1977, deux ans après Villa Triste, Livret de famille de Patrick Modiano est aussi un livre de souvenirs. En épigraphe, cette phrase de René Char : « Vivre, c’est s’obstiner à achever un souvenir. » Le titre s’impose dès le début : la fille de Patrick Modiano est née la veille, il quitte l’hôpital pour aller déclarer sa naissance à la mairie, muni du « petit cahier à couverture de cuir rouge, le « Livret de famille »».
Tous les papiers officiels lui inspirent « un intérêt respectueux », lui-même ne dispose que d’un extrait de naissance incomplet : « fils de » y est suivi d’un blanc. Sur l’acte de mariage de ses parents agrafé au livret (à Megève, le 24 février 1942), son père porte un nom d’emprunt, il en a eu plusieurs sous l’Occupation. Un ami de son père rencontré par hasard la nuit précédente a proposé de l’accompagner en voiture ; il conduit bizarrement, lui parle de son père, puis c’est la panne. Ils arrivent à l’Etat civil juste avant la fermeture.
Modiano a choisi pour sa fille le prénom d’une femme qu’il avait admirée, enfant, « Zénaïde » – refusé, il ne figure pas sur la liste. Son compagnon lui donne alors un coup de pouce, en déclarant que ce prénom est recevable, puisque « c’était le prénom de sa marraine ». L’argument porte. « Cette petite fille serait un peu notre déléguée dans l’avenir. Et elle avait obtenu du premier coup le bien mystérieux qui s’était toujours dérobé devant nous : un état civil. »
A chaque chapitre, Modiano change d’époque, sans transition. Avant ses vingt ans, il rencontre dans un bar quelqu’un qui parle de la Chine. Ils font connaissance. Henri Marignan, un homme d’une soixantaine d’années, y a séjourné sept ans, envoyé à Shanghai par une agence de presse. Il en a raconté ses souvenirs dans Shanghai Perdu. Il rêve d’y retourner et propose au jeune homme de l’y accompagner. Mais pour obtenir l’autorisation de l’ambassade de Chine populaire, c’est compliqué. Rendez-vous, contacts, attente… « Les jours passaient. »
Les récits se suivent comme des nouvelles, le plus souvent fragmentaires mais très vivantes, à partir de lieux, de noms : la rue où a habité sa grand-mère ; Anvers où sa mère est devenue actrice avant d’avoir dix-huit ans ; un voyage en train avec son père pour participer à une chasse sur les terres d’un duc, l’occasion pour son père de faire signer un papier important. Le garçon de quinze ans équipé de nouvelles bottes d’équitation a bien du mal à jouer son rôle chez le « premier fusil de France ».
Un soir d’octobre 1973, une guerre débute au Proche-Orient « contre les Juifs ». Modiano date d’alors la fin de sa jeunesse, le début d’une nouvelle époque « en crise ». Habitué des cafés, des restaurants, des promenades en soirée, l’écrivain voit s’affaisser à une terrasse un homme en pardessus bleu marine. Il sera interrogé comme témoin sur la mort d’André Bourgaloff, né en 1913 à Saint-Pétersbourg, Français depuis 1934.
Livret de famille ne se limite pas aux souvenirs familiaux. Modiano raconte des rencontres, à Paris, à Port-Cros (pour le tournage d’un film dont il a écrit le scénario), à Biarritz (heureux d’y obtenir son extrait de baptême) ou encore à Lausanne. A vingt ans, il y donnait des cours de français, heureux d’être en Suisse, pays « neutre », loin de Paris où l’Occupation le hantait. « Plus de passé. Plus d’avenir. Le temps s’arrêterait et tout finirait par se confondre dans la brume bleue du Léman. J’avais atteint cet état que j’appelais : « La Suisse du cœur »».
Les souvenirs de ses parents le hantent ou refont surface à l’improviste, par exemple quand il pense avoir reconnu un jour l’homme qui a fait arrêter son père rue Greffulhe. Il avait réussi à s’enfuir, ce père, « l’homme de nulle part », comme l’était aussi son oncle Alex qui l’a emmené avec lui, à quatorze ans, pour visiter un moulin à la campagne qu’il rêvait d’acheter. Dans quel village ? « C’était – je crois – un nom mélodieux qui finissait par « euil », quelque chose comme Vainteuil, Verneuil ou Septeuil. »
Il y a plein d’histoires vécues ou rêvées dans Livret de famille, et de troublantes réminiscences. A dix-sept ans, on lui présente une jeune femme blonde, Denise Dressel, vingt-trois ans, stupéfaite de la question qu’il pose alors : « Vous êtes la fille d’Harry Dressel ? » Ils vivront quelque temps ensemble, avant qu’elle s’en aille sans prévenir. « J’ai éprouvé une sensation de vide qui m’était familière depuis mon enfance, depuis que j’avais compris que les gens et les choses vous quittent ou disparaissent un jour. »
Modiano évoque plusieurs moments en compagnie de sa femme, de leur fille. Aussi émouvant que le premier chapitre sur la naissance de Zénaïde, le dernier raconte un trajet en taxi avec elles, à Nice. J’ai d’abord copié les trois dernières phrases, puis je les ai effacées. Je vous laisse le plaisir de les découvrir.